 Les pollutions de l'air
Les pollutions de l'air
 Effet de serre
Effet de serre
 Couche d'ozone
Couche d'ozone
 Pluies acides
Pluies acides
 Smog
Smog
 Les pollutions des eaux
Les pollutions des eaux
 Le traitement des eaux usées
Enquête 2005
Le traitement des eaux usées
Enquête 2005

Depuis 2005, les eaux usées de toutes les agglomérations de
plus de 2000 habitants doivent être traitées dans des stations d’épuration (Directive européenne du 21 mai
1991). Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, tout immeuble doit être raccordé à un système
d’assainissement. Le but est de regrouper les eaux usées afin de les épurer avant de les rejeter.
 Une fosse septique Une fosse septique
 En 2005, plus de 10 millions de Français utilisaient un
assainissement autonome. En 2005, plus de 10 millions de Français utilisaient un
assainissement autonome.
 Les matières organiques contenues dans les eaux usées
subissent une fermentation anaérobie basique, la digestion. Cette dernière produit du gaz
carbonique, de l’hydrogène sulfureux et du méthane. Les bulles entraînent des particules légères à
la surface où elles forment une croute, le chapeau. La boue et l'écume restent dans la fosse,
le liquide sortant se disperse ensuite dans le sol aprs passage dans un élément de drainage. Les matières organiques contenues dans les eaux usées
subissent une fermentation anaérobie basique, la digestion. Cette dernière produit du gaz
carbonique, de l’hydrogène sulfureux et du méthane. Les bulles entraînent des particules légères à
la surface où elles forment une croute, le chapeau. La boue et l'écume restent dans la fosse,
le liquide sortant se disperse ensuite dans le sol aprs passage dans un élément de drainage.
|
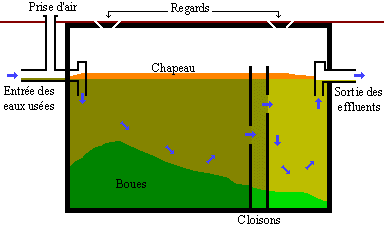
|
 Station d'épuration Station d'épuration
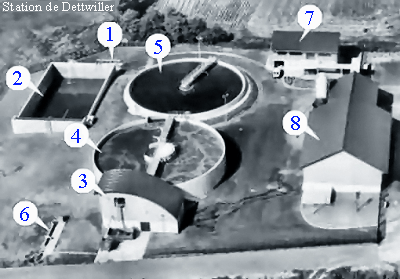
|
1. Bâche de relèvement : les pompes (ou les vis d'Archimède) amènent les eaux au point le plus haut
de la station, pour permettre ensuite leur écoulement gravitaire d'un bassin à l'autre
2. Bassin d'orage : Stockage du surplus d'eau apporté en temps de pluie avant traitement
3. Prétraitement : élimination des éléments facilement séparables :
- le dégrillage retient les corps flottants et les gros déchets dans une grille
- le dessablage élimine les sables et les particules lourdes par décantation
- le dégraissage injecte des bulles d'air qui entrainent les matières grasses à la surface où elles
sont récupérées par raclage
4. Bassin d'aération : le brassage apporte l'oxygène nécessaire aux micro-organismes pour assimiler
les matières polluantes dissoutes. Le mélange obtenu forme les boues activées
5. Clarification : l'eau traitée est séparée des boues par décantation
6. Rejet à la rivière : après analyse, l'eau de surface du clarificateur est rejetée au milieu
naturel
7. Bâtiment d'exploitation : il contient l'alimentation électrique de la station, les dispositifs
de commande des différents appareils et le système de supervision qui permet de suivre le
fonctionnement en temps réel
8. Local de traitement des boues : les boues récupérées sont déshydratées par filtration. Elles
sont ensuite évacuées en vue de compostage ou de stockage, ou gardées sur le site en vue de leur
épandage
|
 Le réseau de collecte des eaux
usées
Le réseau de collecte des eaux
usées

Les réseaux de collecte ou
égouts ont pour fonction de
recueillir les eaux usées de toutes origines et de les acheminer vers les stations d’épuration. Il en
existe deux types :
 - les réseau unitaire
- les réseau unitaire reçoit, en
mélange, les eaux usées et les eaux pluviales.
 - les réseau séparatif
- les réseau séparatif, plus récent,
est composé de deux collecteurs qui séparent les eaux usées des eaux pluviales
 Sous-produits
Sous-produits
 - les réseaux d’assainissement
- les réseaux d’assainissement sont
encombrés par des graviers, des sables, des matières organiques et des détritus divers qui ralentissent la
vitesse d’écoulement des eaux. Les boues de curage représentent 18 kg/habitant/an de matières brutes.
 - les refus de dégrillage
- les refus de dégrillage sont des
déchets solides de toute nature : bois, boîtes de conserve, flacons en plastique, feuilles, etc.
 - les matières de dessablage
- les matières de dessablage sont
récupérées au niveau des pré-traitements (sable, graviers, ou particules lourdes).
 - les matières de
dégraissage-déshuilage
- les matières de
dégraissage-déshuilage sont récupérées par flottation.
 - les boues
- les boues sont constituées de
particules solides non retenues par les pré-traitements en amont de la station d’épuration, des matières
organiques non dégradées, des matières minérales et des micro-organismes (bactéries dégradatives pour
l’essentiel). Elles se présentent sous forme d’une
soupe épaisse qui subit ensuite des traitements
visant en particulier à réduire leur teneur en eau. La quantité moyenne est de 15 kg de matière
sèche/habitant/an.
 - les gaz :
- les gaz : gaz carbonique et azote
qui retournent à l’atmosphère.

Selon l’utilisation qui doit en
être faite, des traitements complémentaires sont appliqués aux boues. Les autres sous-produits de
l’assainissement sont éliminés dans le circuit des déchets municipaux. Les produits minéraux de curage et
de dessablage peuvent être valorisés en remblais, sous réserve d’un nettoyage-calibrage. Les déchets
graisseux sont incinérables ou biodégradables.
 Quelques chiffres
Quelques chiffres
 - Les réseau d'égouts
- Les réseau d'égouts

La France possède 180.000 kilomètres de canalisations d’égouts
qu'utilisent près de 90 % de la population habitant des zones d’assainissement collectif. Pourtant, le
taux de collecte réel n'est que de 68 % en raison notamment de la vétusté de certains réseaux.
 - Les stations d'épuration
- Les stations d'épuration

95% des communes de plus de 10.000 habitants disposent d'une
station d'épuration. La majorité sont de petite taille. Le rendement d'une station est de 73 % en moyenne
(27 % de la pollution reçue en station gagne le milieu aquatique sans être traitée). Le taux de
dépollution (taux de collecte x rendement épuratoire) est donc de 49 %. L'objectif des pouvoirs publics
est d’élever le taux de dépollution à 65 %
 Textes en vigueur
Textes en vigueur
 - Directive européenne du 21 mai
1991
- Directive européenne du 21 mai
1991

Les eaux usées des agglomérations de plus de 15 000
équivalent-habitants (E.H.) doivent être collectées et traitées avant le 31 décembre 2000 au plus tard.
Pour les agglomérations de taille comprise entre 2 000 et 15 000 EH, l’obligation de collecte et de
traitement s’échelonne jusqu’à 2005 selon la taille des agglomérations et la sensibilité des milieux
aquatiques récepteurs.
 - Loi sur l’eau du 3 janvier 1992
- Loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Elle fixe le cadre global de la gestion de l’eau en France sous
tous ses aspects : ressources, police de l’eau, tarification, gestion du service, etc.
 - Décret du 3 juin 1994 - Application de la
loi sur l’eau
- Décret du 3 juin 1994 - Application de la
loi sur l’eau

Ce texte important définit la programmation de l’assainissement
au niveau des agglomérations et son calendrier de mise en œuvre. Il introduit aussi la notion de
zones
sensibles, celle de programme d’assainissement, etc.
 - Arrêtés du 22 décembre 1994 -
Assainissement collectif
- Arrêtés du 22 décembre 1994 -
Assainissement collectif

Ils fixent les prescriptions techniques des réseaux de collecte
et des usines de traitement des eaux usées, ainsi que les modalités de surveillance et de contrôle.
 - Arrêtés du 6 mai 1996 - Assainissement
autonome
- Arrêtés du 6 mai 1996 - Assainissement
autonome

Ils réglementent l’assainissement autonome, établissent les
prescriptions techniques, ainsi que les modalités de contrôle par les communes.
 - Arrêté du 21 juin 1996 - Petites
communes
- Arrêté du 21 juin 1996 - Petites
communes

Il fixe les prescriptions techniques minimales pour les petites
stations d’épuration.
 Obligations des communes
Obligations des communes
 - Choisir un système
d'assainissement
- Choisir un système
d'assainissement

Les communes doivent délimiter, après enquête publique, les
zones relevant de l’assainissement collectif ou de l’assainissement non collectif.
 - Réaliser les ouvrages d’assainissement
collectif nécessaires
- Réaliser les ouvrages d’assainissement
collectif nécessaires

Un programme d’assainissement est rédigé pour diagnostiquer la
situation existante (taux de collecte et rendement épuratoire) et fixer les objectifs et moyens à mettre
en place. L’assainissement collectif se décompose en système de collecte des eaux usées (réseau d’égouts)
et système de traitement (station d’épuration).
 - Exploiter, contrôler les ouvrages
d’assainissement
- Exploiter, contrôler les ouvrages
d’assainissement

Un programme d’autosurveillance du système d’assainissement
doit être établi (rédaction d’un manuel). Les résultats sont transmis au service en charge de la police de
l’eau et à l’agence de l’eau : transmission mensuelle et rapport annuel de synthèse. Les communes doivent
mettre en place des services chargés de contrôler la réalisation et le bon entretien des systèmes
individuels dont les particuliers sont responsables. Elles peuvent proposer un service d’entretien.

Le maire et le conseil municipal choisissent le mode de gestion
du service d’assainissement (collecte et traitement :

- la régie : la commune gère et exploite directement avec son
propre personnel

- la délégation : une société est mandatée par la commune
(concession, affermage...).

Il existe aussi des modes de gestion mixtes de gestion.
 Obligations des particuliers
Obligations des particuliers
 - se raccorder à un système collectif ou
mettre en place un système autonome
- se raccorder à un système collectif ou
mettre en place un système autonome

Les propriétaires ont l’obligation de se raccorder à leurs
frais au réseau collectif s’il passe à proximité de chez eux. Ils doivent payer la redevance qui permet de
financer les coûts d’investissement et d’exploitation du réseau et de la station d’épuration.

En l'absence de réseau collectif, les propriétaires sont tenus
de réaliser un système d’assainissement non collectif, de payer la redevance qui permet d’en financer le
contrôle et éventuellement l’entretien.
 - ne pas jeter de substances contaminantes,
dangereuses ou toxiques dans le système d’assainissement
- ne pas jeter de substances contaminantes,
dangereuses ou toxiques dans le système d’assainissement

Il est interdit d’introduire des matières solides, liquides ou
gazeuses susceptibles d’être la cause d’un danger ou d’une dégradation des ouvrages de collecte ou de
traitement des eaux usées.
 Rôle de l'état
Rôle de l'état
 - fixer les objectifs par
agglomération
- fixer les objectifs par
agglomération

La notion d’agglomération, au sens de la loi sur l’eau de 1992,
ne tient pas compte nécessairement des limites des communes. C’est une unité cohérente de production, de
collecte et de traitement de la pollution, délimitée par arrêté préfectoral.
 - contrôler les projets communaux et le
travail des gestionnaires
- contrôler les projets communaux et le
travail des gestionnaires

Les résultats de l’autosurveillance des systèmes
d’assainissement sont contrôlés par les préfectures. Les services préfectoraux peuvent réaliser des
contrôles inopinés sur les sites d’ouvrages d’assainissement pour vérifier le respect des prescriptions
figurant dans les arrêtés d’autorisation.
 Les départements
Les départements

Les départements apportent des aides financières aux communes
rurales. Ils assurent la répartition des aides du Fonds National d’Adduction d’Eau (FNDAE) en matière
d’assainissement. La plupart d’entre eux disposent de Services d’Assistance Technique à l’Exploitation des
Stations d’Epuration (SATESE) qui aident les collectivités à gérer leur système d’assainissement.
 Les pollutions
atmosphériques
Les pollutions
atmosphériques
 La loi du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
La loi du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie déclare que son objectif est la mise en oeuvre du
droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé : constitue une pollution
atmosphérique au sens de la présente loi l'introduction par l'homme de substances ayant des conséquences
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à
influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives excessives.

L'approche phénoménologique du problème consiste à répertorier
les anormalités atmosphériques (pluies acides, brouillards urbains, effet de serre, trou de la couche
d'ozone) et à étudier leurs causes probables. J'ai préféré, à partir d'une liste d'éléments gazeux
présents dans la nature, décrire les effets inattendus provoqués par le dépassement d'un seuil de
tolérabilité.

Aux classiques polluants considérés comme des indicateurs de la
qualité de l’air (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, particules en suspension, ozone, monoxyde de carbone,
composés organiques volatils et plomb) s'ajoutent d’autres substances telles que les organochlorés
(dioxines et furanes), les hydrocarbures aromatiques (poly/monocycliques), les métaux lourds et les gaz à
effets de serre même si ces derniers ne sont pas des polluants au sens strict du terme.

L'origine des polluants atmosphèriques peut être anthropique
(ménages, industrie, agriculture, transports, etc.) ou naturelle (éruptions volcaniques, feux de forêts,
etc.). Les pollutions industrielles dont le SO2 est l'acteur principal ont connu une baisse significative
avec les contrôles, l’amélioration des processus industriels, et la désindustrialisation. Le bénéfice de
l’amélioration du parc automobile (pots catalytiques, réduction de la consommation) est absorbé par
l’augmentation continue du trafic : les transports sont actuellement un des plus importants producteurs de
NOx et de COV qui, sous l’effet de l’ensoleillement, sont la cause de la pollution photochimique urbaine
(mesurée par l’ozone).
 Les polluants atmosphériques
Les polluants atmosphériques
 SO2 SO2
 dioxyde de soufre dioxyde de soufre
|
 NOx NOx
 oxydes d’azote (NO et NO2) oxydes d’azote (NO et NO2)
|
 O3 O3
 ozone ozone
|
 CO CO
 monoxyde de carbone monoxyde de carbone
 (CO2 : dioxyde de carbone) (CO2 : dioxyde de carbone)
|
 COV COV
 Composés Organiques Volatils Composés Organiques Volatils
|
 Pb Pb
 plomb plomb
|
 HAP/HAM HAP/HAM
 Hydrocarbures Aromatiques Hydrocarbures Aromatiques
 Poly/Monocycliques Poly/Monocycliques
|
 PM10V, PM2.5, PM0.1 PM10V, PM2.5, PM0.1
 particules particules
 de matière fines de matière fines
|
 POP POP
 polluants organiques persistants polluants organiques persistants
|
 L'indice ATMO est un indicateur
d’information grand public sur la qualité de l’air, il concerne toutes les agglomérations de plus de
100 000 habitants dans lesquelles seules sont prises en compte les zones fortement peuplées. L'indice ATMO est un indicateur
d’information grand public sur la qualité de l’air, il concerne toutes les agglomérations de plus de
100 000 habitants dans lesquelles seules sont prises en compte les zones fortement peuplées.
 Pour chaque polluant (SO2, NO2, O3, PM10) un sous-indice
est calculé à partir d’une moyenne des niveaux de présence de chaque polluant sur l’ensemble des
stations. C’est le sous-indice maximal qui est retenu comme indice ATMO final caractérisant la
qualité de l’air globale de la journée considérée. Il s'exprime par un chiffre allant de 1 à 10
associé à un qualificatif (de très bon à très mauvais). Pour chaque polluant (SO2, NO2, O3, PM10) un sous-indice
est calculé à partir d’une moyenne des niveaux de présence de chaque polluant sur l’ensemble des
stations. C’est le sous-indice maximal qui est retenu comme indice ATMO final caractérisant la
qualité de l’air globale de la journée considérée. Il s'exprime par un chiffre allant de 1 à 10
associé à un qualificatif (de très bon à très mauvais).
|
 Les composés
soufrés
Les composés
soufrés
 Le dioxyde de soufre (anhydride
sulfureux)
Le dioxyde de soufre (anhydride
sulfureux)
 Propriétés :
Propriétés : Le SO2 est un gaz
incolore, ininflammable, à odeur piquante, d'une densité de 2,3 par rapport à l'air. Il fond à -75,5°C et
bout à -10°C. Il réagit avec l'eau (hydrolyse) pour former des acides corrosifs (soluble dans l'eau à
raison de 79,79 vol/vol).
 Production :
Production : Il est produit en grande
quantité par les émissions volcaniques, les feux de forêt et la décomposition biologique. À cette
production
naturelle (entre 80 et 288 millions de tonnes) s'ajoutent les 79 Mt produits par toutes
les activités humaines qui utilisent des combustions (centrales thermiques, métallurgie, raffineries,
incinération des ordures, chauffage, transports, etc.). La combustion du charbon est responsable de 50%
des émissions, celle du pétrole de plus de 25%. En 2006, la Chine est le premier pays du monde pour les
émissions de dioxyde de soufre.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz toxique et corrosif.
En faible quantité, il est irritant pour les yeux et les voies respiratoires, en quantité plus importante,
il peut devenir mortel. Ses valeurs guides pour l'OMS sont (seuils de dangerosité) : 20 µg par m3 par
jour, 500 µg par m3 pendant 10 minutes.

Hydrolysé par l'eau contenue dans l'atmosphère, il est sous
cette forme responsable :

- des
smogs
londoniens où, par temps calme et associé aux fumée industrielles, il générait
des brouillards jaunes et noirs épais et dangereux pour la population. Le
grand smog de Londres de
décembre 1952 dura cinq jours, provoqua 4.000 décès et poussa les autorités à règlementer les sources de
fumées et la qualité des carburants.

- des
pluies acides qui, riches en
acide sulfurique, agressent forêts, lacs et constructions.

- d'aggravations de
maladies du système
respiratoire comme l'asthme
 L'hydrogène sulfuré
L'hydrogène sulfuré
 Propriétés :
Propriétés : Le H2S est un gaz
incolore, très inflammable (270°C), à odeur d'oeuf pourri en faible quantité, d'une densité de 1,2 par
rapport à l'air. Il fond à -86°C et bout à -60,2°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 4,67
vol/vol.
 Production :
Production : Il se forme naturellement
dans les marécages par dégradation anaérobique de matière organique.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz toxique,
inflammable, dangereux pour l'environnement. Malodorant (odeur d'œuf pourri !), il est détectable en très
faible quantité (0,002 ppm), irritant à partir de 10 ppm et d'autant plus dangereux au delà de 50 ppm
qu'il affecte le sens olfactif, le système respiratoire et le système nerveux.
 Les oxydes d'azote - NOx -
(monoxyde, dioxyde)
Les oxydes d'azote - NOx -
(monoxyde, dioxyde)

L'azote et l'oxygène ne réagissent pas ensemble à des
températures normales (heureusement !). Les NOx résultent de combustion à haute température dans les
moteurs des automobiles.
 L'azote
L'azote
 Propriétés :
Propriétés : Le N2 est un gaz
incolore, inodore, ininflammable et inerte qui n'entretient pas la vie (a zoe). D'une densité de 0,967 par
rapport à l'air, il fond à -210°C et bout à -195,9°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 0,0234
vol/vol.
 Production :
Production : Il occupe 78,084% de
l'air que nous respirons.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz ininflammable et non
toxique, il peut être asphyxiant à haute concentration.
 Le monoxyde d'azote (oxyde
nitrique)
Le monoxyde d'azote (oxyde
nitrique)
 Propriétés :
Propriétés : Le NO est un gaz
incolore, à odeur faible, ininflammable mais bon comburant. D'une densité égale à celle de l'air, il fond
à -163,6°C et bout à -151,8°C. À température ordinaire, il se décompose en azote et autres oxydes d'azote
mais s'oxyde à l'air en dioxyde d'azote. Il est soluble dans l'eau à raison de 0,074 vol/vol.
 Production :
Production : il est produit par la
combustion à hautes températures du carburant des véhicules routiers, le chauffage domestique, etc.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz toxique, comburant
et corrosif, il est très toxique par inhalation et corrosif pour les yeux, le système respiratoire et la
peau.
 Le dioxyde d'azote (tétroxyde de
diazote)
Le dioxyde d'azote (tétroxyde de
diazote)
 Propriétés :
Propriétés : Le NO2 est un gaz brun
roux, à odeur faible, ininflammable mais bon comburant. D'une densité de 2,8 par rapport à celle de l'air,
il fond à -11,2°C et bout à 21,1°C. Il réagit avec l'eau pour former des acides corrosifs.
 Production :
Production : il résulte en grande
partie de l'oxydation dans l'air du monoxyde d'azote associé aux combustions mais une partie est produite
directement.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz toxique, comburant
et corrosif, il est très toxique par inhalation et réactivité pour les yeux, les voies respiratoires et le
peau (après sa transformation en acide nitrique). Ses valeurs guides pour l'OMS sont (seuils de
dangerosité) : 40 µg par m3 par an, 200 µg par m3 par heure.

Sa présence dans l'atmosphère accentue :

- la pollution urbaine (smog, ozone) et les
pluies acides.

- la fragilisation des voies respiratoires.
 Le protoxyde d'azote (oxyde
nitreux)
Le protoxyde d'azote (oxyde
nitreux)
 Propriétés :
Propriétés : Le N2O est un gaz
incolore, d'odeur douceâtre, ininflammable mais bon comburant. D'une densité de 1,5 par rapport à celle de
l'air, il fond à -91°C et bout à -88,5°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 1,14 vol/vol.
 Production :
Production : il résulte
essentiellement de l'utilisation d'engrais azotés en agriculture.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz comburant. Avec un
potentiel de réchauffement près de 300 fois plus important que celui du CO2, il participe activement à
l'effet de serre.
 L'ozone
L'ozone
 Propriétés :
Propriétés : Le O3 est un gaz bleuté,
à odeur forte, instable et très oxydant. Sa densité est de 1,658 par rapport à celle de l'air, il fond à
-192,5°C et bout à -111,9°C.
 Production :
Production : Dans la stratosphère,
l'ozone se crée et se détruit sous l'effet des rayonnements solaires (couche d'ozone). Sa concentration
reste globalement constante. Dans la troposphère, il se forme par réaction (réversible) entre l'oxygène de
l'air et certains gaz (oxydes d'azote ou hydrocarbures) sous l'effet du rayonnement solaire. Une partie
provient des couches supérieures de l'atmosphère.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz irritant pour les
yeux, la gorge et les poumons. Ses valeurs guides pour l'OMS sont (seuils de dangerosité) : 10 mg par m3
sur 8h, 30 mg par m3 par heure.
 Les oxydes de carbone
(monoxyde, dioxyde)
Les oxydes de carbone
(monoxyde, dioxyde)
 Le monoxyde de carbone (oxyde
carbonique)
Le monoxyde de carbone (oxyde
carbonique)
 Propriétés :
Propriétés : Le CO est un gaz
incolore, inodore et inflammable (630°C). Sa densité est égale à celle de l'air, il fond à -205°C et bout
à -191,6°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 0,0227 vol/vol.
 Production :
Production : Il est produit lors de
combustions incomplètes par manque d'oxygène (chauffage, transports...). Il est rapidement oxydé en CO2
par l'oxygène de l'air.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz inflammable et
toxique, il provoque mots de tête, nausées, perte de motricité, perte de connaissance et coma. Ses valeurs
guides pour l'OMS sont (seuils de dangerosité) : 10 mg par m3 sur 8h, 30 mg par m3 par heure. C'est la
première cause de décès par intoxication en France.

Absorbé dans la fumée de cigarettes, il remplace
l'oxyhémoglobine par la carboxyhémoglobine et diminue la capacité de transport de l'oxygène.
 Le dioxyde de carbone (gaz
carbonique)
Le dioxyde de carbone (gaz
carbonique)
 Propriétés :
Propriétés : Le CO2 est un gaz
incolore, inodore et ininflammable. Sa densité est de 1,52 par rapport à celle de l'air, il fond à -56,6°C
et se sublime à -78,5°C (neige carbonique). Il est soluble dans l'eau à raison de 1,7163 vol/vol.
 Production :
Production : Il est produit par
combustions complètes, respiration, fermentation. Il est absorbé par les plantes.
 Dangerosité :
Dangerosité : Plus lourd que l'air, il
est asphyxiant à forte concentration. C'est le principal responsable de l'effet de serre.
 Les Composés Organiques
Volatils (COV)
Les Composés Organiques
Volatils (COV)
 Nature :
Nature : Les COV sont des produits
chimiques organiques (carbonés) qui se vaporisent facilement à la température ambiante. Souvent incolores
et inodores ils incluent des substances très différentes telles que les hydrocarbures (méthane, benzène,
toluène, HAP, HAM, etc.) et des halocarbures.
 Production :
Production : Ils sont produits par
combustion, utilisation et évaporation des solvants et des carburants industriels. Le benzène est produit
par les véhicules à essence.
 Dangerosité :
Dangerosité : Irritants pour les yeux
et les poumons, iles peuvent engendrer des bronchites par intoxication chronique et être, à long terme,
responsables de cancers. Le benzène peut favoriser la leucémie.
 Le butadiène 1,3
Le butadiène 1,3
 Propriétés :
Propriétés : Le CH2=CH-CH=CH2 est un
gaz incolore, peu odorant et inflammable (415°C). Sa densité est de 1,915 par rapport à celle de l'air, il
fond à -108,9°C et bout à -4,5°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 0,45 vol/vol.
 Production :
Production : Il est produit dans la
fabrication des caoutchoucs synthétiques, par la combution de l'essence des véhicules et par celle du
tabac.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz inflammable et
toxique, il provoque mots de tête, nausées, perte de motricité, perte de connaissance et coma. Il y a une
corrélation apparente entre l'exposition au butadiène et un risque de cancer.
 Le méthane (CH4)
Le méthane (CH4)
 Propriétés :
Propriétés : Le CH4 est un gaz
incolore, sans odeur et inflammable (595°C). Sa densité est de 0,55 par rapport à l'air. Il fond à
-182,5°C et bout à -161,6°C. Il est soluble dans l'eau à raison de 0,054 vol/vol.
 Production :
Production : Il vient de la
fermentation anaérobique dans les marais, les rizières et les élevages d'animaux, mais aussi des
combustions naturelles ou industrielles ainsi que de la dégradation bactérienne des déchets dans les
décharges.
 Dangerosité :
Dangerosité : Gaz très inflammable et
asphyxiant à concentration élévée, il peut former avec l'air un mélange explosif. Il contribue de manière
importante à l'effet de serre et à la production d'ozone troposphérique.
 Le Plomb
Le Plomb
 Production :
Production : La pollution par le plomb
provient surtout des additifs anti-détonants de l’essence. Rejetés dans l’atmosphère, ils se concentrent
de part et d’autre des routes. Le plomb qu’ils contiennent passe alors directement dans l’herbe ou dans
les eaux de ruissellement. L'usage d’essence sans plomb diminue sa production mais, en diminuant le
rendement des moteurs, elle augmente l’émission d’autres polluants comme le monoxyde de carbone. D'autres
sources de production sont les batteries d'accumulateurs, les tuyauteries, les soudures, les peintures
anti-corrosion (minium) et les munitions (on estime 8.000 tonnes les grenailles de plomb des munitions de
chasse et de ball-trap perdues dans l'environnement en France en 2000).
 Dangerosité :
Dangerosité : La toxicité du plomb est
due notamment à son effet inhibiteur de certaines enzymes qui provoque des troubles cérébraux et des
retards mentaux chez les jeunes enfants. Il est aussi la cause du saturnisme.
 Les hydrocarbures
aromatiques cycliques
Les hydrocarbures
aromatiques cycliques
 Les hydrocarbures monocycliques
(HAM)
Les hydrocarbures monocycliques
(HAM)
 Nature :
Nature : Ce sont des composés
organiques très volatils comme le benzène, le toluène, les xylènes (BTX), etc. Ils entrent dans la
composition des carburants mais aussi de solvant, conservateurs, encres, colles, peintures...
 Production :
Production : Ils sont émis par le
milieu naturel (forêts), le secteur résidentiel (chauffage, solvants), les industries (centrales
thermiques, solvants, élimination des déchets), et l'agriculture (engrais) ainsi que lors de leur
transfert (stations services).
 Dangerosité :
Dangerosité : Ils jouent un rôle
majeur dans la formation de l’ozone troposphérique et interviennent également dans le processus d’effet de
serre et du trou d’ozone stratosphérique. Pour les êtres vivants, les effets sont variables selon leur
nature, depuis la simple gêne olfactive (irritation voire diminution de la capacité respiratoire) jusqu’à
des effets mutagènes et cancérigènes, notamment établis pour le benzène.
 Les hydrocarbures polycycliques
(HAP)
Les hydrocarbures polycycliques
(HAP)
 Nature :
Nature : Les HAP sont des composés de
carbone et d'hydrogène dont la structure contient au moins deux noyaux aromatiques condensés
(Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzanthracène, Chrysène, Naphtalène, Benzophénanthrène,
Benzofluoranthène, Dibenzophénanthrène, Benzopérylène, Triphénylène, Benzopyrène, Tétrabenzonaphthalène
(TBN), Phénanthrophénanthrène (PhPh), Coronène, etc. Leur nombre est sans limite car il n'y a pas de
limite au nombre de noyaux accolés et le nombre d’isomères augmente considérablement avec le nombre de
cycles aromatiques.

Les HAP purs sont des substances colorées et cristallines à
température ambiante. Leurs propriétés physiques varient avec leur masse moléculaire et leur structure.
Ils sont très hydrophobes (peu solubles dans l’eau à l’exception du naphtalène) et très absorbant des
matières organiques en suspension dans l’air ou dans l’eau.
 Production :
Production : C'est la combustion
incomplète de matières fossiles qui est la principale source de HAP dans l’environnement (carburant
automobile, combustion domestique, production industrielle, production d’énergie ou encore incinérateurs).
Une partie provient des éruptions volcaniques et des feux de forêts.

Dans l’atmosphère, ils coexistent en phase gazeuse (les plus
légers, deux cycles) et en phase particulaire (les plus lourds, six cycles). En modifiant la pression de
vapeur saturante, la température influence la partition gaz/particule.

Les avancées technologiques (réduction de la consommation, pots
catalytiques, filtres, etc.) diminuent leur production qui reste maximale en hivers.
 Dangerosité :
Dangerosité : Toxiques et
cancérigènes, ils sont présents dans tous les milieux et partie des polluants organiques persistants
(listes de l’agence de protection de l'environnement des États-Unis, l’OMS et de la communauté
européenne).

Ce sont des molécules biologiquement actives qui, une fois
absorbées, peuvent avoir un effet toxique en se liant à des molécules biologiques fondamentales
(diminution de la réponse du système immunitaire par exemple).
 Le Benzo(a)pyrène
Le Benzo(a)pyrène
 Propriétés :
Propriétés : Le C20H12 est un solide
cristallin jaune à cinq cycles.
 Dangerosité :
Dangerosité : C'est un des HAP les
plus toxiques. Sa capacité de réaction avec l'ADN le rend mutagène et cancérigène.
 Les particules de matière
(PM10V, PM2.5, PM0.1)
Les particules de matière
(PM10V, PM2.5, PM0.1)

Ce sont des particules microscopiques solides ou liquides,
d’origine humaine ou naturelle, qui restent suspendues dans l’air pendant un certain temps. Ces particules
varient fortement en taille, composition et origine, et bon nombre d’entres elles sont nocives. Elles
peuvent se présenter sous forme de cendre volante, de suie, de poussière, de brouillard, de fumées,
etc.

En fonction de leur diamètre, on parle de PM10 (particules
grossières), PM2.5 (particules fines, moins de 2,5 µm) ou de PM0.1 (particules ultrafines).

Les particules en suspension sont toutes les particules solides
et liquides suspendues dans l’air dont bon nombre sont dangereuses. Ce mélange complexe contient entre
autres de la poussière, du pollen, de la suie, de la fumée, et des gouttelettes.

Les particules sont soit directement émises dans l’air par les
véhicules à moteur ou les combustions, soit formées dans l’atmosphère par la transformation de gaz émis
comme le SO2.

Les sulfates et la matière organique sont les principaux
composants de la pollution de l’air par les particules. La poussière minérale, le nitrate et la suie
peuvent également être des composants.

L’exposition aux particules en suspension peut nuire aux
poumons des enfants et des adultes et réduire l’espérance de vie, principalement chez les sujets ayant des
antécédents cardiaques et pulmonaires. Lorsque les particules en suspension et d’autres polluants de l’air
sont présents en même temps, les effets individuels de chaque polluant sont cumulés.
 Les polluants organiques
persistants (POP)
Les polluants organiques
persistants (POP)

Appelés les 12 salopards (dirty dozen), ils ont été définis par
la Convention de Stockholm (17 mai 2004). Ce sont des composés organiques qui cumulent faible
biodégradabilité, effet toxique à faible dose et capacité de s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Ils
désignent les PCB, les dioxines, les furanes et neuf substances actives de produits pesticides comme
l'aldrine, la dieldrine, le DDT, l'endrine, le chlordane, l'hexachlorobenzène, le mirex, le toxaphène et
l'heptachlore.
 L'aldrine
L'aldrine, insecticide utilisé contre
les termites et les sauterelles, est encore autorisé pour certains usages spécifiques.
 Le chlordane
Le chlordane, insecticide à large
spectre utilisé contre les termites, est encore autorisé pour certains usages spécifiques.
 Le DDT
Le DDT, insecticide miracle des années
50 pour détruire les insectes vecteurs de la malaria, du typhus et d'autres maladies, continue d’être
employé pour lutter contre la malaria malgré sa persistance et sa toxicité.
 La dieldrine
La dieldrine, insecticide utilisé
contre les termites, les parasites des textiles, les insectes vecteurs de maladies et les insectes vivant
dans le sol des terres agricoles, est encore utilisé pour certains usages spécifiques.
 Les dioxines
Les dioxines, substances produites
involontairement lors d’une combustion incomplète ou sous-produits de la fabrication de pesticides et
d’autres produits chimiques, peuvent également résulter de processus de recyclage de métaux et de
blanchiment du papier. Hautement cancérigènes, leur rejet doit être évité ou minimisé (Accident de Seveso
en 1976).
 L'endrine
L'endrine, insecticide pulvérisé sur
les feuilles des plants de coton et de céréales, est également utilisé pour lutter contre les souris, les
campagnols et autres rongeurs. Elle doit être éliminée.
 Les furanes
Les furanes, produites
involontairement dans les même conditions que les dioxines, se trouvent également dans des préparations
commerciales de PCB. Hautement cancérigènes. Leur rejet doit être évité ou minimisé.
 L'heptachlore
L'heptachlore, insecticide utilisé
pour lutter contre les insectes terrestres et les termites, est également employé contre les parasites des
cultures et les moustiques vecteurs de la malaria. Il devrait être éliminé.
 L'hexachlorobenzène
L'hexachlorobenzène (HCB), fongicide
utilisé contre les parasites des cultures vivrières, est également un sous-produit de la fabrication de
certains produits chimiques et des processus qui libèrent des dioxines et des furanes. Il doit être
éliminé, les rejets involontaires évités ou minimisés.
 Le mirex
Le mirex, insecticide utilisé contre
les fourmis et les termites, est également employé comme agent ignifuge dans les matières plastiques, le
caoutchouc et les appareils électriques. Il devrait être éliminé.
 Les biphényles polychlorés
Les biphényles polychlorés (PVB) comme
le pyralène sont utilisés comme ignifuges dans les appareils électriques et également employés comme
additifs dans le papier, les agents d’étanchéité et les matières plastiques. Ils sont autorisés pour
certains usages spécifiques. Les rejets involontaires devraient être évités ou minimisés. Extrèmement
stables, ils s'accumulent dans les lacs et les océans. (Accident de Reims en 1983).
 Le toxaphène
Le toxaphène (également appelé
camphéchlore), insecticide épandu sur le coton, les céréales, les fruits, les noix et les légumes, a
également été employé contre les tiques et les mites du bétail. Il devrait être éliminé.
 Autres substances dangereuses
Autres substances dangereuses
 La chlordécone
La chlordécone, insecticide.
 L'hexabromobiphényle
L'hexabromobiphényle, agent
ignifuge.
 L'hexachlorocyclohexane
L'hexachlorocyclohexane (HCH, y
compris lindane), insecticide et produit chimique industriel.
 Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), apparaissent généralement naturellement, mais ils sont aussi produits
involontairement dans les combustions incomplètes. Ils peuvent être fabriqués à des fins médicales et pour
fabriquer des teintures, des matières plastiques et des pesticides. Les rejets involontaires devraient
être évités ou minimisés
 L'hexachlorobutadiène
L'hexachlorobutadiène, produit
chimique industriel.
 L'octabromodiphényléther (octaBDE)
L'octabromodiphényléther (octaBDE),
agent ignifuge.
 Le pentabromodiphényléther
Le pentabromodiphényléther (pentaBDE),
agent ignifuge.
 Le pentachlorobenzène
Le pentachlorobenzène, produit
chimique industriel, fongicide.
 Les naphtalènes polychlorés
Les naphtalènes polychlorés, utilisés
pour l’isolation des câbles, la préservation du bois, comme additifs dans les huiles de moteur, comme
matières premières dans la production de teintures, etc.
 Les paraffines chlorées à chaînes
courtes
Les paraffines chlorées à chaînes
courtes, utilisées dans les fluides de traitement des métaux et dans les produits de finissage du
cuir.
 Dangerosité :
Dangerosité : Les scientifiques ont pu
associer l'exposition aux POP avec un large éventail d'impacts sur la santé des êtres vivants. Toutes ces
substances chimiques possèdent une toxicité aiguë, montrée par les catastrophes industrielles de Bhopal
(1984) ou de Seveso (1976), qui se manifeste après une surexposition par des troubles (cutanés,
gastriques, nerveux, hépatiques, etc.) ou le décs (2500 morts en quelques heures à Bhopal).

Les effets à long terme (toxicité chronique) d'exposition à des
doses infimes de POP sont plus pernicieux parce qu'ils se déclenchent avec retard et que l'évaluation
scientifique se heurte aux intérêts industriels : effets cancérigènes, atteinte à la fertilité,
perturbation des systèmes nerveux et immunitaire, perturbation du système endocrinien (système de
régulation des hormones).
 Conséquences de la
Pollution
Conséquences de la
Pollution
 Amplification de l'Effet de serre
Amplification de l'Effet de serre

L'effet de serre est un phénomène thermique bien connu sur les
planètes comme la Terre et Vénus. Une partie du rayonnement solaire traverse l'atmosphère et réchauffe le
sol. Celui-ci émet alors un rayonnement infrarouge dont une partie plus ou moins importante est absorbée
par certains gaz (vapeur d'eau et CO2 sur la Terre, CO2 sur Venus).
 Effet de serre Effet de serre
 50% du rayonnement solaire (UV, lumière blanche, IR)
arrive au sol, 20% est absorbé par l'atmosphère, 30% est réfléchi par celle-ci ou par le sol
(albédo). 50% du rayonnement solaire (UV, lumière blanche, IR)
arrive au sol, 20% est absorbé par l'atmosphère, 30% est réfléchi par celle-ci ou par le sol
(albédo).
 Le rayonnement reçu par la Terre est réémis sous la forme
de rayons infra-rouges. Ceux-ci sont aborbés par les gaz à effet de serre qui les restituent
dans toutes les directions. Le rayonnement reçu par la Terre est réémis sous la forme
de rayons infra-rouges. Ceux-ci sont aborbés par les gaz à effet de serre qui les restituent
dans toutes les directions.
 Sans l'existence de ce phénomène de recyclage
thermique, la température moyenne de la terre serait très inférieure à 0°C (au lieu des 14°C
actuels). Cependant, l'augmentation du volume de ces gaz présents dans l'atmosphère augmente la
quantité de chaleur conservée et donc la température moyenne de la Terre. Sans l'existence de ce phénomène de recyclage
thermique, la température moyenne de la terre serait très inférieure à 0°C (au lieu des 14°C
actuels). Cependant, l'augmentation du volume de ces gaz présents dans l'atmosphère augmente la
quantité de chaleur conservée et donc la température moyenne de la Terre.
|
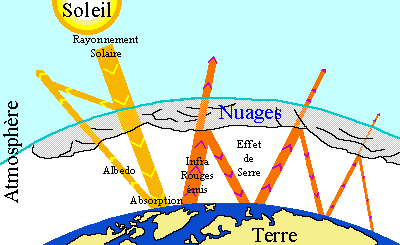
|

Actuellement, les gaz qui participent à l'effet de serre sont la
vapeur d'eau (55%), le dioxyde de carbone (39%), l'oxyde nitreux (4%), l'ozone (1%), le méthane (1%).

Mais l'effet de chacun de ces gaz ne depend pas seulement de
leur quantité relative :

- la vapeur d'eau ne reste que quelques jours dans
l'atmosphère.

- le CO2 a une durée de vie de 100 ans. Il est surproduit
actuellement.

- le méthane qui a une durée de vie de 14 ans, est 21 fois plus
efficace que le CO2 pour capter la chaleur. C'est un des principaux responsable des craintes
actuelles.

- les chlorofluorocarbures (CFC) (présents dans les aérosols)
ont une durée de vie d'un millénaire et captent 10.000 fois mieux la chaleur que le C02. En plus, ils
détériorent la couche d'ozone.

On peut ajouter le protoxyde d'azote, les hydrofluorocarbures
(HFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) et le perfluorométhane de formule (CF4).

La conséquence la plus prévisible d'une augmentation de la
température terrestre est l'élévation du niveau des mers, conséquence de la fonte des glaces polaires.
 Trou de la Couche
d'ozone
Trou de la Couche
d'ozone
 Couche d'ozone Couche d'ozone
 Dans la statosphère, l'ozone (O3) est formé par
l'association d'une molécule d'oxygène avec un atome d'oxygène produit par la dissociation d'une
molécule sous l'action des UV. La couche d'ozone s'étend entre 20 et 50 km d'altitude. Cette
zone dans laquelle la concentration en ozone est plus élevée qu'ailleurs (de l'ordre de 8 parties
par million en volume), a la capacité d'intercepter une grande partie des rayons durs (UV)
émis par le soleil (voir ci-contre la spectaculaire remontée de la température à l'intérieur de la
couche d'ozone). Dans la statosphère, l'ozone (O3) est formé par
l'association d'une molécule d'oxygène avec un atome d'oxygène produit par la dissociation d'une
molécule sous l'action des UV. La couche d'ozone s'étend entre 20 et 50 km d'altitude. Cette
zone dans laquelle la concentration en ozone est plus élevée qu'ailleurs (de l'ordre de 8 parties
par million en volume), a la capacité d'intercepter une grande partie des rayons durs (UV)
émis par le soleil (voir ci-contre la spectaculaire remontée de la température à l'intérieur de la
couche d'ozone).
 Depuis 1974, l'appauvrissement, du printemps à l'automne,
de la couche d'ozone au dessus de l'Antarctique est régulièrement observé. Sous l'action du
rayonnement solaire, les ChloroFluoroCarbures (CFC) produisent des composés chlorés qui détruisent
l'ozone. Ces molécules, utilisées abondamment dans les aérosols ont été interdites. Depuis 1974, l'appauvrissement, du printemps à l'automne,
de la couche d'ozone au dessus de l'Antarctique est régulièrement observé. Sous l'action du
rayonnement solaire, les ChloroFluoroCarbures (CFC) produisent des composés chlorés qui détruisent
l'ozone. Ces molécules, utilisées abondamment dans les aérosols ont été interdites.
 L'atmosphère de la planète est soumise à des mouvement
(vents) horizontaux et verticaux. Le Pôle Sud connaît pendant l'hiver austral, un tourbillon polaire
stable (le vortex) qui l'isole. Pendant la nuit polaire très froide (-80°C), les UV ne détruisent
plus les CFC qui, restent dans les nuages polaire sous forme de cristaux. Au printemps, l'action des
UV sur les cristaux produit de grandes quantités de chlore atomique qui réagit immédiatement avec
l'ozone stratosphérique. L'atmosphère de la planète est soumise à des mouvement
(vents) horizontaux et verticaux. Le Pôle Sud connaît pendant l'hiver austral, un tourbillon polaire
stable (le vortex) qui l'isole. Pendant la nuit polaire très froide (-80°C), les UV ne détruisent
plus les CFC qui, restent dans les nuages polaire sous forme de cristaux. Au printemps, l'action des
UV sur les cristaux produit de grandes quantités de chlore atomique qui réagit immédiatement avec
l'ozone stratosphérique.
 Le phénomène n'est pas observé sur l'Arctique où les
températures hivernales sont plus élevées et les mouvements atmosphériques plus instables. Le phénomène n'est pas observé sur l'Arctique où les
températures hivernales sont plus élevées et les mouvements atmosphériques plus instables.
|
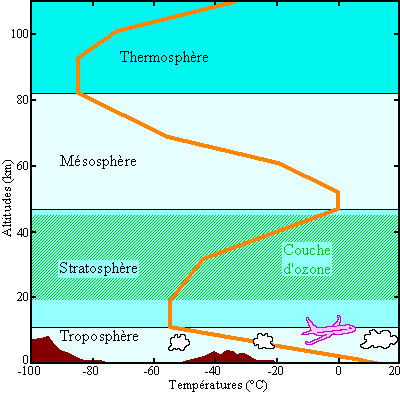
|

En dépit de l'interdiction des CFC, il faudra attendre de
nombreuses années avant que les quantités produites soient éliminés.
 Les rayons ultra-violets
Les rayons ultra-violets

La dangerosité des UV dépend de leur longueur d’onde : plus
elle est petite (courte), plus le danger est grand. La dégradation de la couche d'ozone diminue sa
capacité d'interception des rayons les plus dangereux (B et C) avec pour conséquences possible :

- Pour les être vivants : brûlures superficielles,
conjonctivites, cancers de la peau, maladies du système immunitaire.

- Pour les plantes : réduction de la photosynthèse, disparition
du plancton...

- Pour l'environnement : smog photochimique, production d'ozone
troposphérique, dégradation des peintures et des plastiques
 Les Pluies acides
Les Pluies acides
Les pluies normales, du fait de la présence du gaz carbonique ambiant, ont un pH de 5,6 qui
représente une certaine acidité. Cependant, avec la pollution acide liée aux émissions d'oxydes de
soufre ou d'azote (SO2, NOx, etc.) produits par les activités humaines, leur pH peut être dix fois
supérieur (4,6) et même atteindre des niveaux d'extrème dangerosité (entre 3 et 4).
 Les gaz polluants se répandent dans l'atmosphère où, sous
l'action de la vapeur d'eau, de la chaleur et de la lumière solaire, ils se transforment en acides
(sulfurique ou nitrique). Lorsque la présence d'eau est suffisante, l'ionisation produit les ions
d'hydrogène responsables de l'acidification. Les gaz polluants se répandent dans l'atmosphère où, sous
l'action de la vapeur d'eau, de la chaleur et de la lumière solaire, ils se transforment en acides
(sulfurique ou nitrique). Lorsque la présence d'eau est suffisante, l'ionisation produit les ions
d'hydrogène responsables de l'acidification.
 Les nuages porteurs de pluies acides peuvent répandre
leur contenu à des centaines de kilomètres des lieux où les produits polluants ont été émis. Les nuages porteurs de pluies acides peuvent répandre
leur contenu à des centaines de kilomètres des lieux où les produits polluants ont été émis.
|
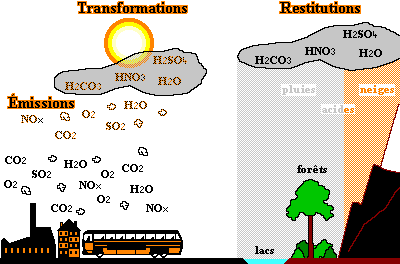
|
 Conséquences des pluies acides
Conséquences des pluies acides

Les retombées acides agissent sur les eaux, la flore et les
constructions humaines :

- Dans les eaux, la faune et la flore sont perturbées.
Paradoxalement, la disparition des organismes vivant fait apparaître les eaux plus claires.

- Les feuilles et l'écorce des arbres sont attaquées (conifères
compris).

- Le calcaire des bâtiments, les métaux des constructions sont
attaqués.

L'installation de filtres à particules sur les voitures, le
contrôle des émissions de gaz sulfureux industriels apportent de sensibles améliorations.
 Les tempêtes de sable
Les tempêtes de sable ou de poussière
sont des phénomènes naturels qui se produisent à proximité de grandes zones arides et semi-désertiques. Le
problème est agravé actuellement par la présence de polluants arrachés dans les zones industrielles
traversées.

Le Sable jaune
hwang sa du printemps coréen sévit depuis
des siècles en provenance du désert mongol de Gobi. Après avoir traversé la zone industrielle de Shenyang
en Chine, il dépose sur la Corée des métaux lourds et d'autres produits polluants toxiques responsables de
dysfonctionnement des communications, de troubles respiratoires chez les humains et de maladies du bétail
et des cultures. En avril 2002, le phénomène a duré 15 jours.
 Les Brouillards
urbains
Les Brouillards
urbains

Le terme SMOG, contraction de smoke (fumée) et fog
(brouillard), s'applique à deux types de pollution qui bien que d'origine différente produisent des effets
semblables.
 Le Smog d'hiver était plus
fréquent autrefois qu'aujourd'hui. La combustion du charbon utilisé pour la production industrielle
et le chauffage des particuliers dégage de grandes quantités de fumées chargées de poussières et du
gaz sulfureux. Par temps calme et humide, les fumées se mélangent aux goutelettes d'eau en
suspension pour former un brouillard roussâtre et irritant. Le Smog d'hiver était plus
fréquent autrefois qu'aujourd'hui. La combustion du charbon utilisé pour la production industrielle
et le chauffage des particuliers dégage de grandes quantités de fumées chargées de poussières et du
gaz sulfureux. Par temps calme et humide, les fumées se mélangent aux goutelettes d'eau en
suspension pour former un brouillard roussâtre et irritant.
 En temps normal, la température diminue quand l'altitude
augmente (6,5°C par kilomètre). Au niveau du sol, l'air pollué plus chaud (donc moins dense), a
tendance à s'élever ce qui disperse les gaz polluants. En hiver, il peut arriver, que l'air à
moyenne altitude soit plus chaud que l'air au sol. Cette inversion thermique crée un
couvercle qui empêche le renouvellement de l'air et provoque l'accumulation des polluants. Le
phénomène peut se produire : En temps normal, la température diminue quand l'altitude
augmente (6,5°C par kilomètre). Au niveau du sol, l'air pollué plus chaud (donc moins dense), a
tendance à s'élever ce qui disperse les gaz polluants. En hiver, il peut arriver, que l'air à
moyenne altitude soit plus chaud que l'air au sol. Cette inversion thermique crée un
couvercle qui empêche le renouvellement de l'air et provoque l'accumulation des polluants. Le
phénomène peut se produire :
 - la nuit, lors d'un refroidissement rapide du sol par
temps clair. - la nuit, lors d'un refroidissement rapide du sol par
temps clair.
 - en zone côtière, quand l'air froid terrestre est retenu
par l'air chaud d'une zone de haute pression. - en zone côtière, quand l'air froid terrestre est retenu
par l'air chaud d'une zone de haute pression.
 - dans une vallée quand l'air froid descend par gravité
le long des pentes. - dans une vallée quand l'air froid descend par gravité
le long des pentes.
|
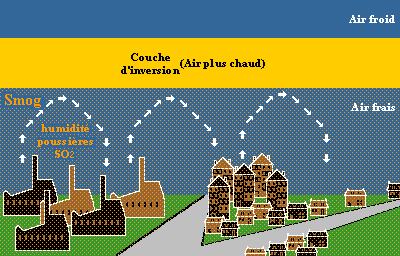
|

Le 4 décembre 1952, un système de haute pression s'installe sur
Londres, le brouillard
normal se sature de particules et d'anhydride sulfureux. Le
Great London
Smog, dense, jaune et irritant dura cinq jours. Il causa la mort immédiate de 4.000 personnes et, dans
les semaines suivantes, celle de milliers d'autres par bronchites, asthmes et maladies cardiaques.

Le contrôle des rejets industriels et des gaz d'échappement des
véhicules automobiles a fortement diminué ce type de pollution.
 Le Smog d'été ou smog
photochimique est plus commun que le smog de l'hiver. Sous l'action de la chaleur et des UV
contenus dans le rayonnement solaire, les oxydes d'azote et les hydrocarbures volatils réagissent
avec l'oxygène de l'air pour produire de l'ozone. Son association avec la vapeur d'eau atmosphérique
et les particules en suspension provoque l'apparition d'une brume bleuâtre irritante, pour les
muqueuses et les plantes. Le Smog d'été ou smog
photochimique est plus commun que le smog de l'hiver. Sous l'action de la chaleur et des UV
contenus dans le rayonnement solaire, les oxydes d'azote et les hydrocarbures volatils réagissent
avec l'oxygène de l'air pour produire de l'ozone. Son association avec la vapeur d'eau atmosphérique
et les particules en suspension provoque l'apparition d'une brume bleuâtre irritante, pour les
muqueuses et les plantes.
 La limitation de la circulation des véhicules automobile
est la solution adoptée en attendant que soient appliquées des contraintes à la production des gaz
et des particules responsables. La limitation de la circulation des véhicules automobile
est la solution adoptée en attendant que soient appliquées des contraintes à la production des gaz
et des particules responsables.
|
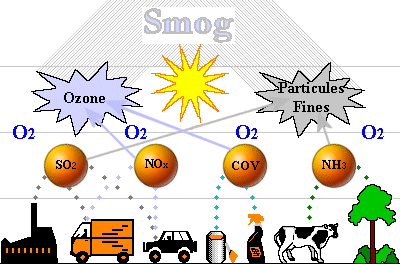
|

Smog d'hiver à Québec
|

Smog d'ozone à Los Angeles
|
 Stockholm (1972)
Stockholm (1972)
 Rio (1992)
Rio (1992)
 Kyoto (1997)
Kyoto (1997)
 Stockholm (2001)
Stockholm (2001)
 Johannesburg (2002)
Johannesburg (2002)
 Grenelle de l'environnement (2007)
Grenelle de l'environnement (2007)
 Les Accords Internationaux
Les Accords Internationaux
 Le Club de Rome
Le Club de Rome 8 avril 1968.
Voir le site (en anglais) -
Commentaires sur le rapport Meadows

Le 8 avril 1968, sous l’impulsion de l'italien Aurelio Peccei
(membre du conseil d'administration de Fiat) et de l'écossais Alexander King (ancien directeur
scientifique de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique), des universitaires, des
économistes et des industriels de cinquante trois pays se réunissent à Rome dans l'Accademia dei Lincei
pour réfléchir d'une façon globale aux problèmes planétaires et proposer des solutions aux dirigeants
nationaux. Le groupe s'installe dans la durée et prend le nom de
Club de Rome.

En 1972 il commande à des universitaires américains du MIT un
rapport sur l'état des ressources naturelles dans le monde. Le rapport Meadows (du nom de deux de ses
auteurs) sous le titre
Limits to Growth (
Halte à la croissance ?) trace un bilan très sombre
de l'avenir. Se basant sur l'évolution de modèles mathématiques, les auteurs mettent en cause le modèle de
croissance actuel qui conduira, d'ici la fin du XXIe siècle, à l'épuisement des ressources indispensables
à la vie humaine que sont la nourriture et les terres arables. Ils initient la notion de
développement
durable, sustainable development en proposant comme solution de freiner la croissance industrielle et
démographique et de s'attaquer à la pollution, notamment grâce au recyclage. Tiré à douze millions
d'exemplaires, traduit en trente langues, la rapport eut un retentissement considérable et devint
immédiatement un ouvrage de référence bien qu'il lui fût reproché, avec son pessimisme, le peu
d'importance accordé à d'éventuels progrès technologiques ainsi que les effets négatifs sur la société
d'un arrêt de la croissance.
 Bibliographie
Bibliographie

- Limits to Growth (Universe Books, 1972) par Donnela Meadows,
Dennis Meadows, Jorgen Randers et William Behrens.

- Traduction franaise : Halte à la croissance ? Rapport sur les
limites de la croissance (Fayard, 1973) accompagné d'une Enquête sur le Club de Rome par la traductrice
Jeanine Delaunay.

- Beyond the Limits. Confronting Global Collapse, Envisioning a
Sustainable Futureen (Chelsea Green Publishing Company, 1993) par Donella Meadows, Jorgen Randers et
Dennis Meadows.

- Limits to Growth. The 30-Year Update (Chelsea Green
Publishing, 2004) par Donella Meadows, Jorgen Randers et Dennis Meadows.

Ces deux ouvrages n'ont pas été traduits en français.

- Les rapports du Club de Rome sont régulièrement publiés.

En 2007, le Club de Rome a quitté Hambourg pour installer son
Secrétariat international à Winterthur dans le Canton de Zurich.
 La Conférence des
Nations-Unies à Stockholm
La Conférence des
Nations-Unies à Stockholm du 5 au 16 juin 1972.
Lire la déclaration finale

Le 5 juin 1972 le premier
Sommet Planète Terre qui
s’ouvre en Suède à l’initiative de Sverker Åström a pour objectif l’amélioration des conditions de vie en
liant développement et environnement dans le cadre d'une coopération internationale. Sa déclaration finale
définit en 26 principes un Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Pour la première fois,
elle demande aux gouvernements d’être attentifs aux activités humaines susceptibles de provoquer un
changement climatique et d’en évaluer les conséquences.

Elle propose également d’établir des stations pour surveiller à
long terme les phénomènes météorologiques. Ces observations, coordonnés par l’OMM, doivent aider la
communauté mondiale à déterminer la part imputable à l’activité humaine dans les modifications
climatiques. Elle programme une nouvelle réunion sur l’environnement et crée le Conseil d’administration
du PNUE à Nairobi au Kenya, le Fonds pour l’environnement et le Comité de coordination pour
l’environnement.

- Il faut éliminer les armes de destruction massive.
 La Conférence des
Nations-Unies à Rio
La Conférence des
Nations-Unies à Rio du 3 au 14 juin 1992.
Lire la déclaration
finale

Le
Sommet Planète Terre de Rio s'ouvre le 3 juin 1992
devant 117 chefs d'Etats ou de gouvernements et 178 pays. Elle s'achève sur l'adoption des 27 principes de
la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui précise la notion de
développement durable.
 Principe 1 : Les êtres humains sont
au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature
Principe 1 : Les êtres humains sont
au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature.
 Principe 4 : Pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considéré isolément
Principe 4 : Pour parvenir à un
développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considéré isolément.

Elle énumère dans le programme d'action pour le XXIe siècle
Action (Agenda) 21 2.500 recommandations qui restent la référence pour l'évolution vers un
développement durable.

Au cours de la Conférence sont adoptées :

- la Convention sur le Climat qui aborde le problème des
émissions de gaz à effet de serre.

- la Déclaration sur les forêts.

- la Convention sur la biodiversité qui donne un cadre à
l'utiisation du patrimoine génétique mondial.

Pour mesurer les progrès de mise en œuvre des résolutions,
promouvoir le partenariat international et encourager de nouvelles activités, une Commission du
développement durable (C.D.D.) est constituée. Composée de plus de 50 pays membres, elle se réunit chaque
année pour faire le point.
 Le Protocole de Kyoto à la
Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
Lire le contenu
Le Protocole de Kyoto à la
Convention-Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
Lire le contenu

Après de longues négociations, le 11 décembre 1997 a été signé
le Protocole de Tokyo, engagement à lutter contre le changement climatique par réduction des émissions de
gaz carbonique. Il donne un cadre quantitatif et juridique à l'engagement qu'avait pris les pays riches de
stabiliser en 2000 leurs émissions de gaz dangereux au niveau de 1990. Les gaz concernés sont :

- le gaz carbonique, CO2 (combustion des énergies fossiles,
déforestation)

- le méthane, CH4 (élevage des ruminants, culture du riz,
décharges d'ordures, exploitations pétrolières)

- les halocarbures, HFC et PFC (réfrigérants, aérosols)

- le protoxyde d'azote, N2O (engrais azotés)

- l'hexafluorure de soufre, SF6 (transformateurs
électriques).

Les pays signataires acceptent de réduire de 5,5% leurs
émissions sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990. Des mécanismes de
flexibilité sont prévus :

- permis d'émission (possibilité de vendre ou d'acheter le
droit d'émettre).

- mise en œuvre conjointe (crédit d'émission par arrangement
entre pays développés).

- mécanisme de développement propre (crédit d'émission par
arrangement entre un pays développés et un pays en développement).

La Conférence des parties au Protocole de Marrakech de décembre
2001 a fixé les critères d'éligibilité des projets au titre des mécanismes de mise en œuvre conjointe ou
de développement propre.

Son entrée en vigueur était soumise à trois contraintes :

- qu'au moins 55 pays le ratifient (réalisé le 23 mai 2002 avec
la ratification par l’Islande).

- que la somme des émissions des pays signataires représente au
moins 55% des émissions de CO2 de 1990 (réalisé le 18 novembre 2004 avec la ratification par la
Russie).

- un délai de 90 jours après la ratification du dernier pays
nécessaire au quorum validant le traité.

Il est entré en vigueur le 16 février 2005. Néanmoins, sa
crédubilité souffre du retrait en 2001 des États-Unis qui émettent un tiers des gaz à effet de serre.
 Convention de Stockholm sur
les Polluants Organiques Persistants
Lire le contenu
Convention de Stockholm sur
les Polluants Organiques Persistants
Lire le contenu

Il s'agit d'un accord international qui utilise le principe de
précaution et vise à interdire ou règlementer certains produits polluants. Signé le 22 mai 2001 par 151
pays et ratifié par 127, il a pris effet le lundi 17 mai 2004. Son secrétariat permanent est à Genève.

Les Polluants Organiques Persistants (POPs) sont définis à
partir de quatre propriétés : ils sont toxiques ; ils résistent à la dégradation ; ils s’accumulent dans
les organismes vivants ; ils sont propagés par l’air, l’eau et les espèces migratrices. Ils ont un point
commun, ce sont tous des dérivés organochlorés.

La Convention désigne douze polluants
les douze salopards,
the dirty dozen utilisés comme pesticides, fluides thermiques et diélectriques, intermédiaires de
synthèse (hexachlorobenzène, endrine, mirex, toxaphène, chlordane, heptachlore, DDT, aldrine, dieldrine,
PCB), ou qui résultent de procédés industriels (dioxine, furanne), et organise le contrôle de ces
substances et des dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternative à leur utilisation (DDT contre la
malaria par exemple).

Lors de la 3e COP (Conférence des Parties) de Dakar en 2007, le
Comité d’étude des POPs a souhaité ajouter 5 substances (pentabromodiphényléther, chlordécone,
hexachlorobiphényle, lindane, sulfonate de perfluorooctane) à la liste et mis en place un groupe de
travail pour évaluer les risques de 5 autres produits chimiques (octabromodiphényléther,
pentachlorobenzène, paraffines chlorées à chaîne courte, alpha-hexachlorocyclohexane,
bêta-hexachlorocyclohexane).
 Le Sommet de
Johannespurg
Le Sommet de
Johannespurg du 26 août au 4 septembre 2002
Lire le
rapport

Le Sommet Mondial du Développement Durable avait pour objectif
d'une part de faire le bilan et de compléter les failles du plan lancé lors du sommet de Rio (Rio+10),
d'autre part de dynamiser l’engagement politique envers le développement durable en favorisant le
renforcement d'un partenariat entre le Nord et le Sud.

Le plan d'action en 153 articles (615 alinéas) porte sur de
nombreux sujets : pauvreté, consommation, ressources naturelles, globalisation, respect des Droits de
l'homme. Les thèmes prioritaires étaient :

- l'eau (ressources, consommation, assainissement,
répartition)

- l'énergie (consommation, répartition, énergies
renouvelables)

- la productivité agricole (état des sols)

- la biodiversité

- la santé

Les intérêts divergents s'accordèrent néanmoins pour mettre le
développement durable au centre des préoccupations environnementales, économiques, sociétales.
 Le Grenelle
Environnement
Le Grenelle
Environnement du 24 au 26 octobre 2007
Site
internet

Il s'agit d'un ensemble de rencontres ayant pour but de prendre
en France des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable. Annoncé par
Alain Juppé, ministre de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables, il a fait suite au
Pacte écologique proposé par Nicolas Hulot.

La préparation a été confiée à six groupes de travail composés
de 40 membres appartenant à cinq collèges (État, collectivités locales, ONG, employeurs, salariés) qui se
sont répartis en ateliers pour débattre des sujets suivants :

- Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la
demande d’énergie

- Préserver la biodiversité et les ressources naturelles

- Instaurer un environnement respectueux de la santé

- Adopter des modes de production et de consommation
durables

- Construire une démocratie écologique

- Promouvoir des modes de développement écologiques favorables
à l’emploi et à la compétitivité

Chaque groupe devait se réunir quatre fois, mais la majorité
des groupes a organisé une ou deux réunions supplémentaires. Deux ateliers intergroupes ont été crées :
l'atelier OGM et l'atelier Déchets.

Les synthèses et les rapports de chaque groupe ont été rendus
publics le jeudi 27 septembre à 11h. Les synthèses ont ensuite été soumises au public dans les régions et
sur l'internet.

Présidée par Nicolas Sarkozy, la table ronde du Grenelle de
l'environnement a eu lieu en présence de Wangari Maathaï et d'Al Gore, tous deux prix Nobel de la paix, et
de José Barroso, président de la Commission européenne, afin de définir un certain nombre de propositions,
mesures et annonces.

Le rapport général reprend le contenu consensuel des travaux
préparatoires et se présente comme un
cadre de cohérence pour action publique selon trois priorités
que sont :

- la lutte contre le réchauffement climatique

- la protection de la biodiversité

- la réduction des pollutions.

Il n'est pas un programme et ne contient aucune sélection ni
hiérarchisation des propositions énoncées.

Dans le discours donné en conclusion le Président de la
République s'est engagé à suivre les propositions contenues dans le rapport.
![]() Les pollutions de l'air
Les pollutions de l'air
![]() Effet de serre
Effet de serre
![]() Couche d'ozone
Couche d'ozone
![]() Pluies acides
Pluies acides
![]() Smog
Smog
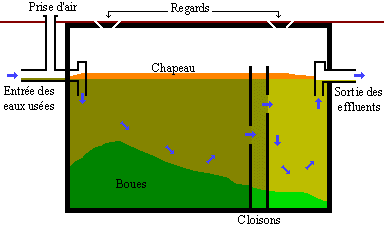
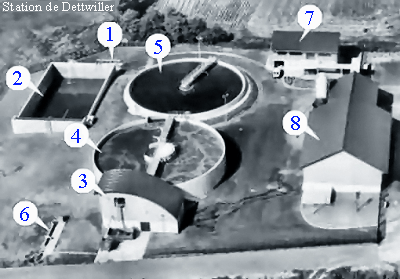
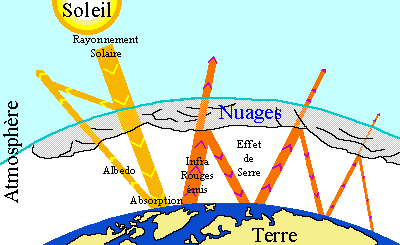
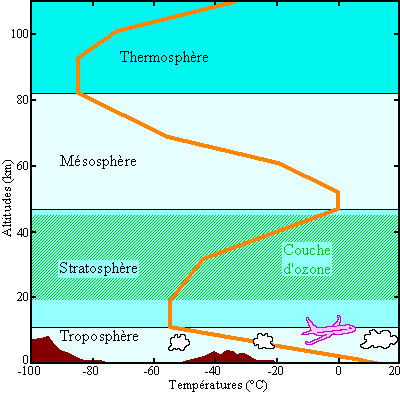
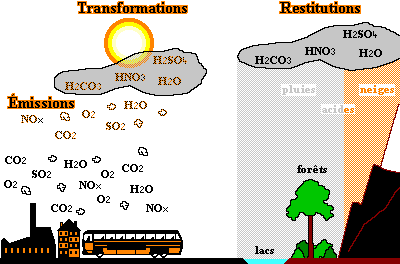
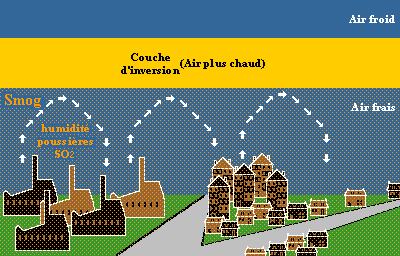
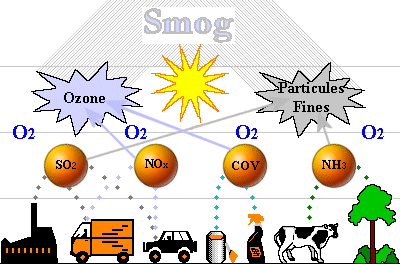


![]() Stockholm (1972)
Stockholm (1972)
![]() Rio (1992)
Rio (1992)
![]() Kyoto (1997)
Kyoto (1997)
![]() Stockholm (2001)
Stockholm (2001)
![]() Johannesburg (2002)
Johannesburg (2002)
![]() Grenelle de l'environnement (2007)
Grenelle de l'environnement (2007)
