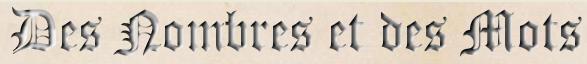
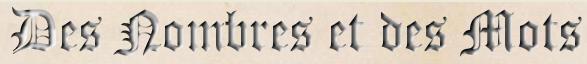
Cette page détaille la numérotation des feuilles du compoix, les unités d'aire utilisées pour évaluer les bâtiments et les propriétés, le système qui permet de répartir les impositions, et le vocabulaire employé pour la description des propriétés.
La numérotation des pages - Elle utilise la numération romaine classique (en minuscules ce qui surprend un peu) souvent sans la notation soustractive (mais la numérotation des articles est en chiffres arabes).
       
|
| Remarquez la notation des centaines (avec le c pointé en exposant), l'enchaînement des i en ponts, le j final, les points sur les i (263, 206, 292, 274 mais pas 264 ni les centaines), la ressemblance entre le v (206) et le l (270), et les lettres répétées quatre fois (292, 274, 264 mais pas 219). |
Elle commence au premier article du compoix (les documents du préambule ne sont pas numérotés).
Les mesures d'aires - La canne
et le pan sont utilisés à l'intérieur des habitations.
Ces mesures de longueurs expriment des surfaces sans que
soit mentionné qu'il s'agit de leur carré. Le pan est un "empan",
écartement maximum de l'extrémité des doigts d'une main ouverte, la canne perdure
dans le "canner" des joueurs de pétanque.![]() La salmée
(saumado), le cestier (sétier), la carte (quarte) et le boissel sont
utilisées pour les mesures d'extérieur (cours, jardins, champs, bois). Ces mesures
de capacité représentent les surfaces qu'elles pouvaient
ensemencer.
La salmée
(saumado), le cestier (sétier), la carte (quarte) et le boissel sont
utilisées pour les mesures d'extérieur (cours, jardins, champs, bois). Ces mesures
de capacité représentent les surfaces qu'elles pouvaient
ensemencer.
| Type de grandeur | Nom | Relation | Arrondi actuel |
| Longueur | Canne | 1 canne = 8 pans | 2 mètres |
| Longueur | Pan | 1 pan = 1/8 canne | 25 centimètres |
| Aire (intérieur) | Canne carrée | 1 canne carrée = 8 pans carrés(1) | 4 mètres carrés |
| (1) Une canne "linéaire" contient 8 pans "linéaires" cependant le pan utilisé pour les surfaces n'est pas un "pan carré" (qui correspondrait à 1/64 de canne carrée) mais une autre unité égale à 1/8 de canne carrée. Il correspond à une bande rectangulaire d'une canne de long sur un pan de large. | |||
| Aire (intérieur) | Pan carré | 1 pan carré = 1/8 canne carrée | 0,5 mètres carrés |
| Aire (extérieur) | Salmée |
1 salmée = 1600 cannes carrées 1 salmée = 4 cestiers = 16 cartes |
64 ares |
| Aire (extérieur) | Cestier(2) |
1 cestier = 400 cannes carrées 1 cestier = 4 cartes = 1/4 salmée |
16 ares |
| Aire (extérieur) | Carte |
1 carte = 100 cannes carrées 1 carte = 4 boissels = 1/4 cestier = 1/16 salmée |
4 ares |
| Aire (extérieur) | Boissel |
1 boissel = 25 cannes carrées 1 boissel = 1/4 carte |
1 are (100 mètres carrés) |
| (2) Les arpenteurs du présent compoix ne comptent que rarement en cestier. Ils utilisent plutôt un nombre de carte inférieur à une salmée. | |||
Les impositions - L'estimation (présage) qui correspond à chaque possession est exprimée en livres, sols, deniers, mailles, pougèzes et pit(t)es à partir de la table donnée aux experts. Elle quantifie la part des richesses de la communauté détenue par chaque contribuable et permet, par simple proportionnalité de déduire l'imposition réelle. Le total des sommes détaillées dans le registre de 1661 est de 100 livres 3 sols maille pite et demie, il en résulte qu'un foyer fiscal dont le présage est d'environ 3 livres sera imposé pour environ le 3/100 de la somme demandée à la communauté (contrairement à mon calcul "à la louche", les calculs étaient très précis puisque la plus petite unité, la pite, représentait 1/1920 de livre et pouvait être encore partagée en quatre).
| 1 livre = 20 sols | 1 sol = 12 deniers | 1 denier = 2 mailles | 1 maille = 2 pougèzes | 1 pougèze = 2 pites | 1 pite = 4 quarts de pite |
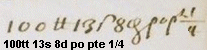     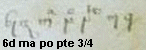 
|
| Remarquez l'abréviation tt
pour livres, le s (en parapluie) pour sols, le d (à longue queue)
pour deniers, ma pour mailles, po pour pougèzes, pte pour
pites, et la
curieuse écriture de la fraction 3/4 (iii q barré) |
Remarque : Il peut paraître surprenant, lorsqu'on regarde les comptes de l'ancien régime, de constater que la livre, le sol et le denier n'existent, homonymies mises à part, que dans les documents comptables. Cette monnaie de compte détermine, à travers les époques et les dépréciations, le pouvoir d'achat de la monnaie réelle, sonnante et trébuchante, dans la vie quotidienne. De semblables équivalences donnent un cours légal à un grand nombre de monnaies étrangères.
La description des propriétés -
![]() Quelques
mots - Item, adverbe classique des énumérations,
signifie En outre, De même. Illec,
du latin Illic, signifie Ici, En ce lieu. Sive
signifie Ou encore. Soubz est une écriture
de Sous.
Quelques
mots - Item, adverbe classique des énumérations,
signifie En outre, De même. Illec,
du latin Illic, signifie Ici, En ce lieu. Sive
signifie Ou encore. Soubz est une écriture
de Sous.
![]() L'orientation - Elle
est donnée par le soleil (le Couchant pour l'Ouest,
le Levant pour l'Est), les vents dominants (le Marin
- le vent de la pluie - pour le Sud, la Bise,
le Vent Droit ou l'Aure Droite
- le Mistral - pour le Nord), ou la pente (le Chef
pour le Haut, le Pied pour le Bas, et les Côtés
pour le reste).
L'orientation - Elle
est donnée par le soleil (le Couchant pour l'Ouest,
le Levant pour l'Est), les vents dominants (le Marin
- le vent de la pluie - pour le Sud, la Bise,
le Vent Droit ou l'Aure Droite
- le Mistral - pour le Nord), ou la pente (le Chef
pour le Haut, le Pied pour le Bas, et les Côtés
pour le reste).![]() Les
confronts - En l'absence de voisinage, les limites sont définies par les
répères naturels visibles sur le terrain. Sont notés :
Les
confronts - En l'absence de voisinage, les limites sont définies par les
répères naturels visibles sur le terrain. Sont notés :
- les cours d'eau
dont, bien sûr, la rivière de Ganière, les gours qui
la jalonnent, les béals et les boutades
qui détournent et retiennent l'eau motrice
des moulins, les valats qui alimentent sa longue
traversée du terroir. Ils existent encore mais le creusement de la voie ferrée,
les rejets de l'extraction minière,
et l'urbanisation ont profondément modifié le cours inférieur de ceux qui descendent de la
Côte.
- les serres et les rancs,
grands ou petits, avec leur aiguevers (versant), leur sommité
(sommet), leur avers (adret) et leur charrau
(?). Ils délimitent parfois les séparations avec les taillables voisins.
-
les grandes voies de communication (rues, drailles, routes
et grands chemins vers les paroisses voisines) et leurs croisements éventuels
(cros), mais aussi les chemins locaux et les nombreux
sentiers (viols) qui parfois traversent les pièces
et mènent aux champs, aux bois, aux fontaines ou aux puits, et aux indivis
communaux. Leur importance actuelle n'est pas toujours celle de l'époque et
ils ont parfois disparu dans des propriétés
privées.![]() Les
pièces de terre - Les propriétés qui touchent aux habitations sont dites joignant
et sont décrites
dans le même article que celles-ci. Une terre faisant pointe a la
forme
de triangle. Une terre faisant escaire n'est pas située
sur un acol,
sa surface est constituée par deux ou plusieurs parties rectangulaires qui en
multiplient les confronts.
Les
pièces de terre - Les propriétés qui touchent aux habitations sont dites joignant
et sont décrites
dans le même article que celles-ci. Une terre faisant pointe a la
forme
de triangle. Une terre faisant escaire n'est pas située
sur un acol,
sa surface est constituée par deux ou plusieurs parties rectangulaires qui en
multiplient les confronts.![]() Les
cultures - Je n'ai pas terminé, loin s'en faut, la totalisation comparative
des surfaces cultivées
du mandement. Les terres cultivées sont des jardins secs ou arrosables, des
prés secs, herboux ou avec faculté de prise d'eau,
des chènevières dont le chanvre peut être filé, des
terres laborives sans que soit mentionné leur ensemencement,
des vignes complantées (car on ne dîme pas, en principe, le haut avec le
bas) de fruitiers ou d'oliviers. Les arbres cités sont les muriers qui fournissent la nourriture des
magnans (vers à soie), les noguiers
(noyers), quelques mattes (bosquets) de fanabrègues
(micocouliers) dont la plasticité est utilisée pour la fabrication d'outils
agricoles.
En bordure de rivière on trouve
des piboules (peupliers), des gravas
(gravières) et des vigières (oseraies). Plus loin poussent les
châtaigniers souvent en nouvelles plantades car l'arbre
à pain est en pleine extension, puis des chênaies, des issards (landes
défrichées), et des hermas (landes incultes) bruguières
(bruyère), boissières (buis), elzières
(chênes verts) ou
rouvières (chênes blancs) mais le pin, qui a colonisé en la détruisant la forêt actuelle,
n'est qu'exceptionnellement cité
Les
cultures - Je n'ai pas terminé, loin s'en faut, la totalisation comparative
des surfaces cultivées
du mandement. Les terres cultivées sont des jardins secs ou arrosables, des
prés secs, herboux ou avec faculté de prise d'eau,
des chènevières dont le chanvre peut être filé, des
terres laborives sans que soit mentionné leur ensemencement,
des vignes complantées (car on ne dîme pas, en principe, le haut avec le
bas) de fruitiers ou d'oliviers. Les arbres cités sont les muriers qui fournissent la nourriture des
magnans (vers à soie), les noguiers
(noyers), quelques mattes (bosquets) de fanabrègues
(micocouliers) dont la plasticité est utilisée pour la fabrication d'outils
agricoles.
En bordure de rivière on trouve
des piboules (peupliers), des gravas
(gravières) et des vigières (oseraies). Plus loin poussent les
châtaigniers souvent en nouvelles plantades car l'arbre
à pain est en pleine extension, puis des chênaies, des issards (landes
défrichées), et des hermas (landes incultes) bruguières
(bruyère), boissières (buis), elzières
(chênes verts) ou
rouvières (chênes blancs) mais le pin, qui a colonisé en la détruisant la forêt actuelle,
n'est qu'exceptionnellement cité![]() Les
habitations - Les maisons d'habitation peuvent avoir galerie (passage
couvert) et degrés
(escaliers d'où étage),
posséder un four à cuire pain ou un pigeonnier, et être entourées de cours, basse-cours, hières
(aires à battre), ubis (dépendances, aires à fumier) et jardins. Les bâtiments
agricoles sont des chazals (bâtiments divers), des
clèdes (sèchoirs à châtaignes), des palhers
(paillers), des granges
parfois découvertes, des caves, des escuviers (cuviers), des étables,
des jasses (abris) de bétail ou de pourceaux. Les bâtiments "industriels"
sont des martinets (marteaux hydrauliques), des paradous
(pour battre la laine), des moulins à bleds ou à fer,
des forges ou des teulières (tuileries).
Les
habitations - Les maisons d'habitation peuvent avoir galerie (passage
couvert) et degrés
(escaliers d'où étage),
posséder un four à cuire pain ou un pigeonnier, et être entourées de cours, basse-cours, hières
(aires à battre), ubis (dépendances, aires à fumier) et jardins. Les bâtiments
agricoles sont des chazals (bâtiments divers), des
clèdes (sèchoirs à châtaignes), des palhers
(paillers), des granges
parfois découvertes, des caves, des escuviers (cuviers), des étables,
des jasses (abris) de bétail ou de pourceaux. Les bâtiments "industriels"
sont des martinets (marteaux hydrauliques), des paradous
(pour battre la laine), des moulins à bleds ou à fer,
des forges ou des teulières (tuileries).